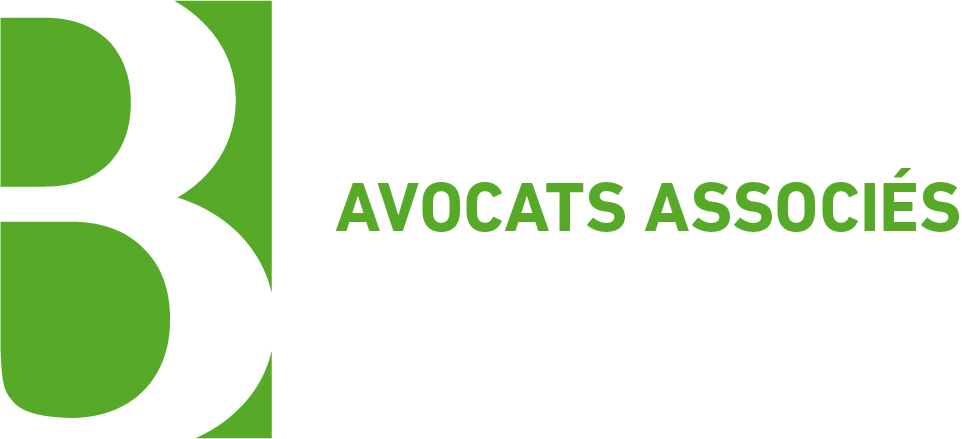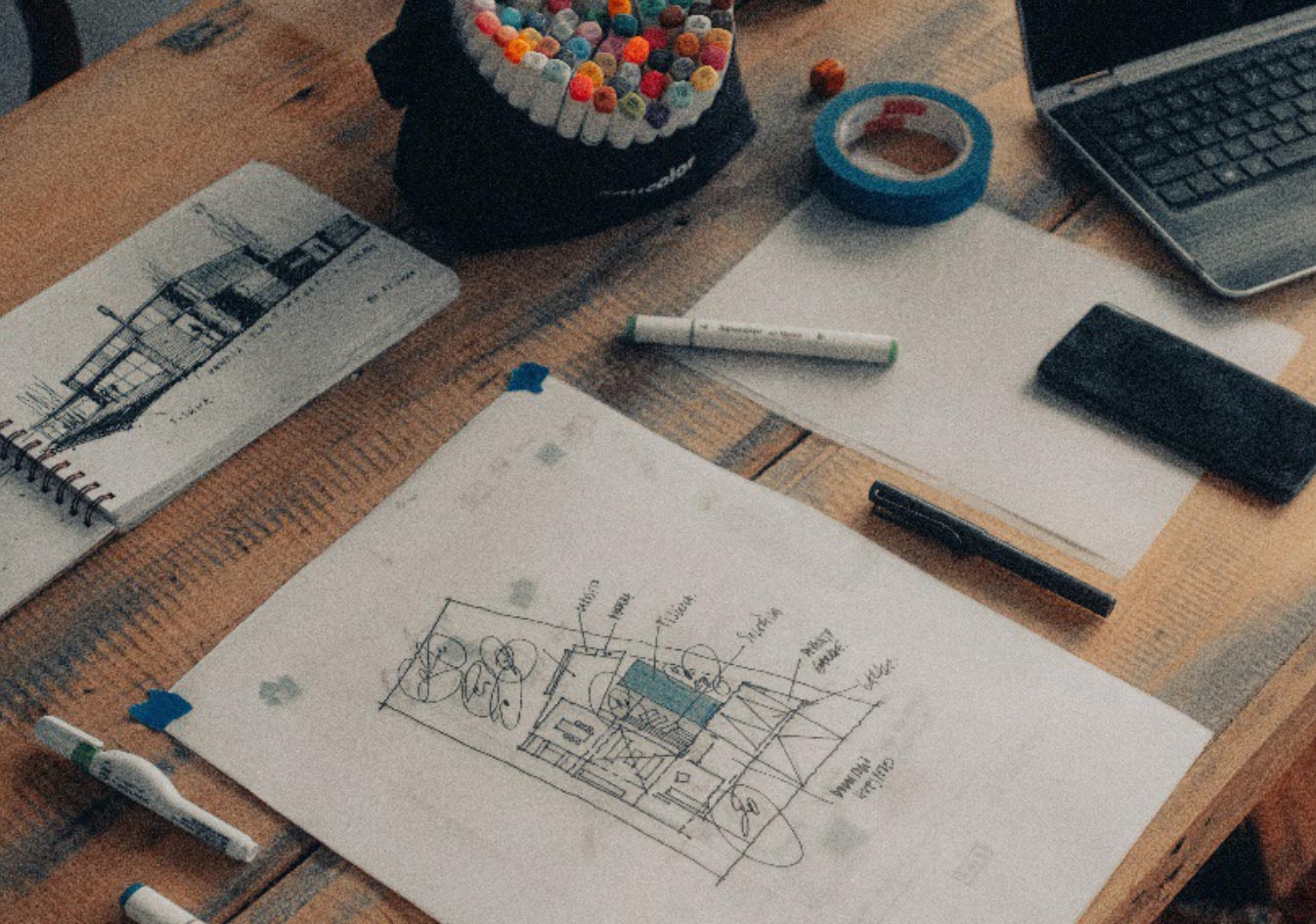Clarification des modalités de régularisation des autorisations d’urbanisme et le recours à l’autorisation modificative en vertu de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme.
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée soit par des modifications intrinsèques au projet (procédure ou fond), ou par des modifications extrinsèques au projet (changement des circonstances de droit ou de fait).
Mais dans tous les cas, même en cas de modification extrinsèque lorsque la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entre-temps modifiée, la régularisation reste subordonnée à l’intervention d’une autorisation en tirant les conséquences.
L’arrêt du Conseil d’État, en date du 4 mai 2023, sous le numéro 464702, met en évidence l’importance de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme concernant la mesure de régularisation par une autorisation modificative.
Cet arrêt revêt une grande importance dans le domaine de l’urbanisme, car il clarifie les modalités de régularisation des autorisations d’urbanisme et le recours à l’autorisation modificative en vertu de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme.
L’affaire soumise au Conseil d’État concernait une société, Octogone, qui avait obtenu une autorisation d’urbanisme pour un projet de construction. Cependant, il est apparu que des modifications mineures étaient nécessaires pour se conformer aux règles d’urbanisme en vigueur. La question clé était de savoir si ces modifications pouvaient être réalisées par une simple autorisation modificative ou si une nouvelle demande d’autorisation était nécessaire.
Le Conseil d’État a statué que, dans le cadre de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, la mesure de régularisation peut être effectuée par une autorisation modificative. Il a précisé que cette mesure de régularisation ne nécessitait pas une nouvelle demande d’autorisation complète, mais plutôt une simple modification de l’autorisation d’origine.
Cette décision du Conseil d’État est cohérente avec l’objectif de simplification et d’efficacité des procédures d’urbanisme. En permettant une régularisation par une autorisation modificative, le Conseil d’État favorise une approche pragmatique qui évite de surcharger les procédures administratives pour des modifications mineures.
L’arrêt met également en évidence l’importance de garantir la conformité des projets de construction aux règles d’urbanisme. En permettant une régularisation par une autorisation modificative, le Conseil d’État offre une voie de résolution rapide et efficace pour les situations où des modifications mineures sont nécessaires pour respecter les règles en vigueur.
Cet arrêt du Conseil d’État apporte donc une sécurité juridique et une guidance précieuse aux acteurs du secteur de l’urbanisme. Il encourage une approche plus souple et pragmatique de la régularisation des autorisations d’urbanisme, tout en garantissant le respect des règles d’urbanisme et la protection de l’intérêt général.